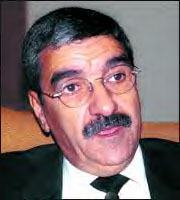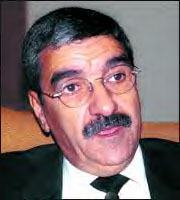
SAÏD SADI
Secrétaire général du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie
Originaire de la crête des Aghribs, non loin
d'Azazga, Saïd Sadi est né le 26 août 1947 dans une partie de la Kabylie à
forte présence de colons avant l'Indépendance. Il se réclame volontiers de
la tradition nationaliste très marquée dans sa région et au sein même de sa
famille. Très tôt il rencontre les influences berbèristes qui se sont déployées
face à l'Etat hyper-centralisateur du colonel Boumediène au début des années
70. Son parcours militant est déjà tracé. La répression primaire du pouvoir
fera le reste.
Médecin en psychiatrie, les cheveux presque longs et le verbe coupant, Saïd
Sadi incarnait bien, il y a vingt ans, la fronde de la jeunesse kabyle contre
l'Etat paternaliste et autoritaire. Dans le feu du mouvement, le Printemps
berbère le conduira à son propre acte de fondation politique: il se rebelle
contre Hocine Aït-Ahmed, chef du Front des forces socialistes (FFS), le parti
clandestin au sein duquel Sadi militait depuis quelques années déjà.
« Les orientations venues de l'exil ne tenaient pas compte de la réalité
du terrain», expliquera-t-il plus tard. Les traits d'un leader autonome et
ambitieux sont déjà plus qu'esquissés. À la longue ils finissent par convaincre
jusqu'à quelques-uns de ses anciens adversaires idéologiques au sein de l'avant-garde
étudiante kabyle.
En avril 1980, après l'assaut violent de policiers
contre l'université de Hasnaoua à Tizi Ouzou, le nom du docteur Sadi figure
en tête des 24 détenus présentés à l'instruction de la cour de sûreté de l'Etat
de Médéa. La puissance de la protestation populaire et étudiante les libérera
deux mois plus tard.
Le printemps suivant, la mobilisation pour Tamazight est toujours aussi forte,
mais le docteur Sadi, traqué par l'administration du ministère de la Santé,
n'y occupe plus une place centrale. Son départ du FFS avec un petit groupe
de militants, dont son frère Hend, l'isole un moment face à la montée des
courants marxisants au sein du Mouvement culturel berbère (MCB).
Le « berbéromatérialisme » a alors
le vent en poupe et devra subir en premier la seconde vague de répression
de juin 1981 à laquelle échappe le docteur Sadi. Il participe cependant à
la campagne pour la libération des détenus dans un contexte de reflux de la
mobilisation. A la sortie de cette période ses proches découvrent un homme
changé, capable de longues périodes de repli et de réflexion.
C'est désormais sur le terrain de la revendication démocratique qu'il décide
en priorité d'orienter son combat. Il revient sur le devant de la scène en
fondant, en 1985, la première ligue des droits de l'homme en Algérie avec
les trotskistes de Louiza Hanoune et des personnalités comme maître Ali Yahia
Abdennour. Cette fois-ci le pouvoir du président Chadli a la main lourde.
Saïd Sadi et plusieurs autres animateurs d'associations jugées illégales sont
condamnés à des peines de prison de plusieurs années. Ils seront élargis au
bout de deux ans de détention. Saïd Sadi, qui aura été arrété cinq fois, est
marqué par son séjour carcéral à Berrouaghia, puis à Lambèze, le redoutable
bagne colonial.
Abdelaziz Bouteflika avait fait de sa venue
dans le gouvernement une priorité. Il n'a réussi qu'à moitié. Premier homme
politique algérien à revendiquer la laïcité de l'Etat face à la montée islamiste
, Saïd Sadi, leader du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)
sait se réserver des portes de sortie, même s'il est surtout réputé pour les
passions qu'il déclenche. Comme en janvier 1992, au lendemain de la victoire
électorale du FIS, lorsqu'il demande l'intervention de l'armée pour « protéger
la République». Ce qui lui vaudra les sentiments les plus opposés. Mais le
docteur Sadi, devenu député en 1997, n'en a cure.
Pour ses adversaires, cette expérience l'a rendu amer sur l'utilité des sacrifices
et ouvert une seconde vie politique, celle qui le conduira, 13 ans plus
tard, à faire entrer son parti dans un gouvernement largement dominé par ses
adversaires politiques de toujours, les « islamo-conservateurs »
en tête.
Il va toujours au bout de ses choix avec un sens redoutable de la formule. Il l'a encore montré en 1999 en refusant de se présenter aux élections présidentielles en dépit de la pression persistante des militants de son parti. Sadi était l'homme le plus comblé par le retrait des six candidats car cela lui donnait raison aux yeux de sa base mécontente de son renoncement. Il scellait ainsi son dernier acte d'opposant, chef de file controversé des modernistes. Sa trajectoire depuis quelques années obliquait vers le soutien conditionnel au régime.
Lors des élections présidentielles d'Avril 2004, il se présente comme le cadidat du RCD. Malheureusement, il n'obtient que 1,93 % des voix avec une quatriéme place aprés Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika (83,49 %), le candidat du FLN, Ali Benflis (7,93 %) et le candidat islamiste d'EL ISLAH, Djaballah (4,84%).
Algeria Interface -